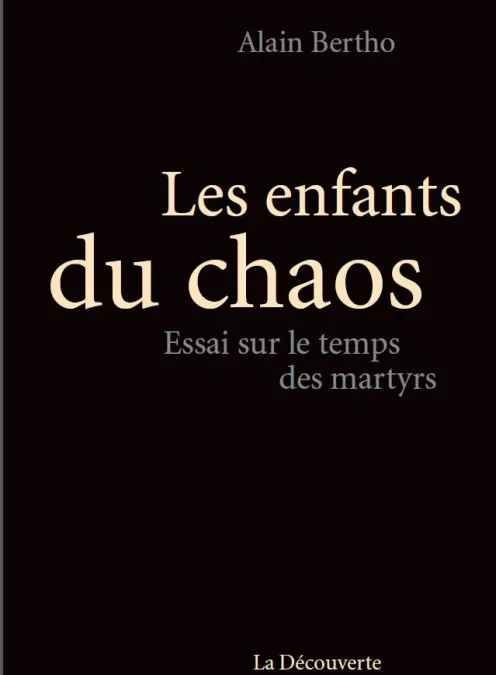Emeutes et politique
Bienvenus au XXIème siècle
Alain Bertho in Banlieues, lendemains de révolte, La Dispute, 2006
« Trop longtemps plongés dans le noir, À l’écart des lumières et des phares, Éclairés par l’obscure clarté de l’espoir, Les enfants des cités ont perdu le contact, Refusent de paix le pacte. Conscients qu’ils n’en sortiront pas intacts, Vivre libre, aspirer au bonheur, Se donner les moyens de sortir du tunnel pour voir la lueur. Et pouvoir tapisser de fleurs les murs de l’amour. La France est accusée de non-assistance à personne en danger, Coupable crient les cités, mais l’Etat malgré ça fera payer les dégâts. »
NTM, « Qui paiera les dégâts ? » 1993
Ceux qui, en France, ont été surpris par les événements qui ont secoués les nuits des villes dans la première quinzaine du mois de novembre 2005 ont traversé les trois dernières décennies dans une confortable torpeur intellectuelle et politique. Ce sont ceux qui n’ont pas voulu écouter ni même seulement entendre les messages insistants depuis vingt ans, de l’authentique parole politique issue de la jeunesse populaire contemporaine : le Rap, ce blues de notre modernité, a été marginalisé, disqualifié culturellement voire condamné en justice[1]. Et il se trouve encore aujourd’hui des parlementaire pour rêver tout haut de sa pénalisation..
Voici un quart de siècle en effet qu’après les premières alarmes des Minguettes en 1981 ou de Vaux en Velin en 1990, tous les ingrédients de l’explosion s’accumulaient sans que rien de sérieux ne soit vraiment tenté pour arrêter l’engrenage. Est-il nécessaire de revenir sur ces ingrédients ? Ils sont sous nos yeux : précarisation, élargissement de la pauvreté, mise en pièce des protections sociales, ségrégations urbaines aggravées, traitement policier de la question sociale, discrimination et racisme d’Etat. Les mots semblent sonner creux à force d’avoir été répétés. Mais ils ne sonnent ainsi que parce qu’ils ont été désincarnés par la parole publique.
Mis à distance par les services de l’Etat et une partie de ses agents, objets de statistiques plus qu’interlocuteurs, les femmes et les hommes qui sont victimes de ces ségrégations et de ces injustices sont comme mis en quarantaine de parole légitime et cumulent ainsi le déni à la souffrance sociale qui leur est infligée.
Les voitures qui brûlent sont la partie visible du désespoir social et politique des oubliés des alternances. « Sauvageons » hier, « racaille » aujourd’hui et toujours et au quotidien marqués du sceau infamant de leurs origines et de la disqualification sociale de leurs familles, des gamins, en défaut de parole, ont cet automne exprimé par leurs actes ce que les adultes disent autrement : par l’abstention, par des jacqueries électorales, par leur rejet global de la « classe politique ».
On a eu tendance à oublier année après année, voire génération après génération, que les dites « questions » du chômage, de la pauvreté, de la banlieue, de l’immigration n’étaient pas constituées que d’indicateurs statistiques. Ce sont surtout des vies et des visages, des centaines de milliers de consciences, d’espoirs et de souffrances dont le surgissement et la parole constituent toujours une surprise politique et médiatique.
Quand on y pense un peu, on s’étonne qu’il ait fallu tant d’années, tant d’humiliations, tant d’insultes publiques, tant de bavures policières, tant de contrôles au faciès dans les « check points » de la République sécuritaire pour que la révolte explose. Comme on peut s’étonner de la relative retenue de cette révolte : beaucoup de voitures brûlées certes mais bien peu d’atteintes aux personnes, peu d’affrontements directs, si peu de coups de feu.
« Il est trop tard »
Peu de surprise donc. Mais dans le même temps qui prend vraiment la mesure de l’événement que nous venons de vivre et qui, pour une part n’est pas clos ? Il ne s’est pas trouvé un seul parlementaire pour tenter de saisir le conseil constitutionnel lors de la prolongation de l’Etat d’urgence en dehors de toute justification minimale. Pendant que la répression s’abat et que les condamnations se comptent par centaines, le monde politique reste très discret sur une nécessaire amnistie. Quand un ministre dénonce la polygamie comme cause des violences, c’est sur la polygamie que titre la presse, et pas sur l’énormité du propos[2]… Quand Alain Finkielkraut se laisse aller à des propos inqualifiables maiss ans ambiguité dans un journal israélien[3], Le Monde lui fournit une page entière pour dire la même chose en termes plus châtiés…
Cet événement politique et culturel déborde largement ces trois semaines explosives. Les réactions politiques, l’Etat d’urgence établi par une loi de guerre coloniale prolongée pour trois mois comme le consentement général que cet usage a rencontré, le quasi consensus pour condamner la violence au nom de la République, les dérapages verbaux des ministres ou d’un philosophe sur la haine de la France posent les jalons d’une nouvelle période. En matière politique, en matière intellectuelle, il y aura un avant et un après. L’événement cristallise une situation nouvelle sans retour en arrière possible.
Nous nous sommes demandés, jour après jour : où est la gauche ? Où est la gauche d’alternative, censée être forte de la victoire du Non le 29 mai 2005 ? Quelles initiatives prend-elle pour tenter de donner une voix à cette révolte des enfants de la mondialisation ? Qu’a-t-elle à dire à cette jeunesse sinon que ce n’est pas bien de brûler des voitures et des écoles ? Quelle initiative prend-elle pour défendre les libertés ?
Comme l’exprime l’économiste Christian Marazzi, « il est désormais «trop tard»: on ne peut plus retourner en arrière, et soit on nage avec le courant, (…), soit on s’empoisonne de ressentiments en faisant appel à des souvenirs toujours plus fanés »[4]. Nous vivons l’aboutissement d’une longue crise, une crise conjointe de la gauche et de la République. L’affaire dure depuis au moins vingt ans. La gauche est alors portée au pouvoir par la victoire électorale de François Mitterrand après des années de défaites ouvrières. On a beaucoup dit et écrit sur la responsabilité du mitterrandisme dans l’enlisement durable de l’espérance politique. A juste titre. Mais cette critique salutaire ne nous exonère pas de la critique des forces qui n’ont su ni éviter cet enlisement, ni proposer une alternative. L’enlisement est collectif car c’est dans une certaine communauté de culture politique que la gauche politique, dans sa large masse, est restée comme tétanisée devant les nouveaux enjeux de l’époque.
La révolution urbaine
La prophétie d’Henri Lefebvre s’est réalisée et la révolution urbaine a eu lieu[5]. Territoire de vie, de travail ou d’exclusion, de coopération ou d’affrontement, de liberté et de démocratie ou de quadrillage policier, la ville est aujourd’hui la marmite bouillonnante et biopolitique qui remet en jeu toutes les dimensions de la vie collective. La ville est notre horizon collectif, pour le meilleur ou pour le pire.
En installant la politique de la ville (d’abord nommée « développement social des quartiers »), la gauche a montré très tôt son souci de prendre en compte les nouvelles questions urbaines révélées par les événements des Minguettes pendant l’été 1981. Mais elle l’a fait dans un cadre de politiques contractuelles défensives, dérogatoires au droit commun de la République, territorialisées, temporaires et expérimentales. Le ratage est bien là : dans l’incapacité culturelle à penser l’enjeu urbain comme la nouvelle question sociale.
Car, avec la métropolisation contemporaine est inséparable de la mondialisation bien sûr mais aussi de la dominance progressive du travail immatériel. La ville a changé de nature[6]. C’est La société urbaine, plus que l’entreprise elle-même qui est devenue le lieu de création de richesses humaines, culturelles, informationnelles, coopératives. Ce sont ces richesses qui sont aujourd’hui les plus productrices de plus value et d’humanité. Mais à l’instar de la classe ouvrière dans l’usine depuis le XIX ème siècle, ce sont les principaux créateurs de cette richesse qui sont précarisés, stigmatisés, ségrégués, « moralisés » et contrôlés. Le discours bien pensant sur les quartiers populaires et cosmopolites des métropoles retrouve sans effort les accents de la bourgeoisie moralisatrice sur les classes dangereuses d’il y a un siècle et demi…
L’espace de l’exploitation et de l’affrontement de classe a changé. Le « rapport salarial » qui fut sur deux siècles le cadre de l’affrontement dans l’entreprise, des conquêtes et des compromis sociaux garantis par l’Etat doit être élargi au monde urbain dans son ensemble pour poser les enjeux de vie, de survie, de droits et de production du commun que génère la métropolisation. Le droit aux services publics de proximité, le droit de circuler librement dans de bonnes conditions, le droit au logement, le droit à la citoyenneté de résidence, le droit à un cadre de vie urbain harmonieux, ne sont pas des suppléments d’âme ou de droit dérivés des enjeux de classe qui resteraient centrés dans ce rapport salarial. Ce sont aujourd’hui des enjeux directs du nouveau mode de production urbain. L’idée de « Grenelle des banlieues »[7], rend assez bien compte de ce glissement de rationalité et d’échelle politique qu’il nous faut maintenant opérer.
C’est ce basculement politique et culturel qui n’a jamais vraiment eu lieu. Les tensions urbaines ont été vécues comme périphériques au regard de l’affrontement au sein de l’entreprise. Ces nouvelles tensions n’ont pas été vues comme de nouveaux fronts à tenir mais comme une source de difficulté pour les fronts traditionnels. Les quartiers ouvriers des générations précédentes avaient été vécus comme des bastions. Les nouveaux quartiers du prolétariat urbain sont regardés comme des « ghettos » que la gauche elle-même propose parfois de disperser au nom de la « mixité sociale ». La nostalgie des luttes obscurcit, pour nombre de militants, la conscience des enjeux du présent : « le nouveau n’efface pas le passé, mais seulement fait du passé un obstacle pour affronter le futur avec intelligence, avec des capacités de créer de nouveaux affects, de produire de nouvelles luttes politiques. »[8]. Militants du droit au logement dès 1990, sans-papiers en 1996, chômeurs en décembre 1997, sont successivement accueillis avec réticence dans le cercle des luttes légitimes et toujours suspects de surenchère ou de divisions potentielle.
Un peuple humilié
Or cette réticence politique et culturelle de la gauche a porté sur les questions les plus sensibles pour les nouvelles classes populaires : le racisme culturel et social, la discrimination au quotidien, la stigmatisation de la jeunesse, le traitement policier des questions sociales et urbaines. Ce qui devient le vrai cœur des enjeux politiques du siècle qui s’ouvre, ce qui devrait être l’armature du nouveau rassemblement populaire et démocratique, est surtout pour la gauche un terrain d’hésitation voire de division passionnelle.
Quoi d’étonnant dans ces conditions qu’elle offre un front désuni, une résistance molle, voire une perméabilité certaine à la stratégie de l’épouvantail agitée par la droite politique ou culturelle. « Les riches ont tiré un rideau sur les pauvres, et sur ce rideau ils ont peint des monstres… ».[9] Comment parler autrement de cette stigmatisation successive des classes dangereuses contemporaines : la question dite de « l’immigration » dès le début des années 80, la question de la « sécurité » dans la foulée des années 90, la question des « ghettos » à résorber pour finir sur l’air de « l’islam versus laïcité » de ces dernières années.
Sur ces questions successives, la majorité de la gauche de gouvernement n’a pas combattu la droite. Elle l’a accompagnée, justifiée, excusée, contestée à la marge, sur ses méthodes, jamais sur le diagnostic. A ses reculades sur la déréglementation sociale, elle a ajouté son assentiment à la disqualification politique, morale et culturelle des classes populaires. Ce peuple urbain n’a pas seulement vécu la précarisation de masse. Il a vécu l’humiliation.
Et l’autre gauche ? Si la gauche mouvementiste n’a globalement pas failli, il n’en est pas de même des partis. Lorsque, durant l’hiver 2004-2005 la « gauche de la gauche » se rassemble en faveur d’un NON au projet de Constitution européenne, elle prend bien soin de mettre de côté et de passer sous silence ces fameux sujets … qui la fâche aussi. « L’appel des indigènes de la République »[10] lancé par un réseau de jeunes militants le plus souvent issus de l’immigration ou de la France coloniale, en fait les frais et se trouve mis à l’index comme une démarche de division
Or cette gauche d’alternative requinquée par la défaite du OUI le 29 mai 2005 est, quelques semaines plus tard, singulièrement silencieuse devant le surgissement de cette révolte « hors cadre ». Gauche d’alternative, où est donc passée ta victoire ? L’antilibéralisme est-il soluble dans le combat pour les droits et les libertés contre les discriminations ? La conception républicaine de l’Etat qui fut l’un des points de référence du NON est-il encore un repère présentable aux enfants de la révolte ?
Quand la République divise
La République ne va pas bien. Elle a parfois des airs désuets et inquiétants de République de Weimar. La crispation défensive dont elle est l’objet, notamment à gauche, est le symptôme de cette mauvaise santé[11].
Dans ces deux siècles industriels, qui furent aussi les siècles de gloire des Etats nations, la République a incontestablement été la meilleure machine à intégrer du symbolique c’est-à-dire à produire du commun par delà les conflits ou les différences. C’est sur cette articulation de l’Etat et de l’universel que vient aujourd’hui échouer le vieux modèle. L’Etat républicain est inséparable du peuple souverain, constitué dans son unité nationale[12]. Mais que devient ce souverain populaire national à l’heure de la ville-Monde, à l’heure où la production du commun qu’on nomme pudiquement « le vivre en ensemble » est un enjeu quotidien?
La Déclaration des droits de l’homme dans la ville portée depuis 2000 par un réseau de villes européennes propose une autre définition de la citoyenneté : « la ville est un espace collectif appartenant à tous les habitants » et en conséquences les droits « sont reconnus à toutes les personnes vivant dans les villes signataires, indépendamment de leur nationalité », désignées comme « citoyens et citoyennes des villes »[13], sans condition d’appartenance nationale ni même de régularité de séjour ….
On est loin de la constitution républicaine d’un peuple-nation comme unité citoyenne abstraite. Certes cette dernière a montré son efficacité dans la promotion et la défense de l’individu politique contre toutes les chaînes communautaires, familiales, culturelles, clientélistes, religieuses ou villageoises. Mais cette libération a eu un prix : ce qui rassemble les uns les sépare des autres. Cette libération identifiée à la citoyenneté nationale porte une injonction de rupture à celui qui veut en bénéficier. Elle crée sur le territoire lui-même au moins deux catégories de citoyens : les citoyens de plein droits et les autres, sommés, s’ils veulent le devenir, de « s’intégrer » et donc de rompre avec leurs liens antérieurs. Cette République est jalouse. Elle ne partage pas. L’injonction fonctionne tant qu’elle est libératrice. C’est sur ce dernier point que porte le doute contemporain.
Que reste-t-il à la République à offrir en échange de cette allégeance ? La casse systématique des droits et protections construites au niveau national autour du rapport salarial par plus de vingt ans de néolibéralisme ?
Le déplacement des lieux et des niveaux de décisions dans la toile économique européenne ou mondiale risque de ne laisser aux républicains, au mieux, que de la nostalgie. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de résister. La gauche a été envoyée plusieurs fois au gouvernement par les électeurs, pourtant de plus en plus sceptiques, sans enrayer la dérive. Des mobilisations sociales d’ampleur se sont succédées depuis la grève monumentale de novembre décembre 1995 sans engranger la moindre victoire durable. La victoire du non au projet de Constitution européenne n’a en rien freiné la pente libérale dominante de cette construction.
L’impuissance affichée de la République comme rapport politique autant que comme pouvoir s’ajoute à l’expérience de masse de l’accroissement des inégalités, de la pauvreté, des discriminations. La crise de la représentation que dessinent la montée de l’abstention, les tentations populistes comme les diverses jacqueries électorales est une profonde crise de l’identité nationale et républicaine.
Cette impuissance est aussi l’impuissance à assurer la paix civile et à faire face à la montée d’une violence interpersonnelle dont les principales victimes sont les couches populaires. La réponse sécuritaire, policière, quasi guerrière, de l’Etat stigmatise les victimes en coupables collectifs, les territoires délaissés en territoires dangereux, ajoute de la violence d’Etat à la mal-vie, attise les tensions et les méfiances, achève de délégitimer les règles collectives…
La guerre est une forme possible de gouvernement. Une partie de la droite l’a compris qui développe aujourd’hui un langage de « rupture ». Cette droite là propose un nouveau contrat « républicain » (ce qualificatif est-il encore d’actualité en la circonstance ?) basé sur la garantie policière et sécuritaire du libre jeu du marché et sur un arbitrage inter-communautaire en partenariat avec les églises quelles qu’elles soient. Ce modèle a sa cohérence, celui du pompier pyromane qui attise les tensions entre les gens pour mieux être le garant de la paix armée. Il est crédité d’une certaine crédibilité électorale. La machine à abolir les libertés est déjà en marche. Et comme toujours « sous les applaudissements » selon le mot de la princesse Padmé dans le troisième épisode de la Guerre des Etoiles…
Nous sommes tous des indigènes
Tel est le paradoxe : pour assurer la continuité disciplinaire d’une République qui fut viscéralement anti-communautariste, le pouvoir peut faire le choix de communautariser la République. De quoi s’agit-il d’autre lorsque qu’une loi sur la laïcité impose l’obligation de neutralité aux usagers de l’école et non plus à la seule institution ? Lorsqu’un préfet de la République refuse de délivrer sa carte de séjour à une femme au prétexte qu’elle porte un voile ? Lorsqu’on assimile nationalité étrangère et couleur de peau ?
L’Etat qu’on nous propose n’est plus l’Etat de tous : il est potentiellement celui des « bons citoyens », des « braves gens », de ceux qui font allégeance à des normes et plus seulement à des lois, à une morale privée plus qu’à des règles publiques. La résurgence de la posture coloniale trouve ici toute son actualité et toute son ampleur. Quel symbole que de voir ainsi remobilisée, 50 ans après, la loi du 3 avril 1955 instaurant l’Etat d’urgence et votée en son temps pour permettre de mener la guerre dans les Aurès… Ceux qui sont d’abord visés, dans la continuité d’une République qui fut aussi colonisatrice, ce sont évidemment et violemment tous les enfants, petits enfants, arrières petit enfants des indigènes à qui, selon la loi du 23 février 2005[14] la République est censée avoir apporté tant de bienfaits…
C’est pourquoi le travail politique et culturel de mémoire collective sur le colonialisme et l’esclavage est aujourd’hui une urgence. Car la production du commun passe par la reconnaissance d’une mémoire partagée. Rien ne serait pire qu’une balkanisation des mémoires qui mettrait en concurrence les victimes et attiserait la haine de leurs descendants.
Mais ce travail n’épuisera certainement pas la question. Car le nouveau dispositif étatique n’est pas seulement la résurgence d’un passé qui ne passe pas. C’est une posture à bien des égards nouvelle et générale : nous sommes tous, potentiellement des indigènes… « Nous sommes d’ici : nous sommes des Iciens », lance Jamel Debbouze devant les jeunes de Clichy sous bois le 20 décembre 2005. Comme l’ont si bien vu les Zapatistes du Chiapas depuis plus de dix ans, la question indigène n’est pas une question particulière, ce n’est pas un problème de minorités. C’est une figure contemporaine d’exigence de droits pour tous et de singularités respectées pour chacun.
Face à cet Etat de guerre dont l’état d’urgence semble un ballon d’essai, il ne s’agit plus de refonder une République qui ne produit de l’égalité que sous condition d’appartenance nationale, qui circonscrit le collectif citoyen avant de lui donner du contenu commun. La vision étatico-nationale de la question sociale est devenue régressive et dangereuse ne serait-ce que parce qu’elle produit de la division et de la frontière au cœur même des villes, entre les gens eux-mêmes[15]. Depuis un quart de siècle dans le monde, l’affirmation nationale, qui fut si longtemps synonyme de libération, a été avant tout un vecteur de guerres civiles…
S’il reste un avenir à l’idée républicaine ce n’est certainement pas dans le cadre de l’Etat national mais dans celui d’un espace urbain ouvert de droits et d’égalité pour tous. Il faut tout à la fois déterritorialiser et urbaniser la République. Nous avons besoin d’une légitimité collective qui construise du commun de façon inclusive, par agrégation et non par séparation.
Nous sommes tous des indigènes urbains. Il tient à nous et à nous d’abord d’être des indigènes solidaires malgré, voire contre, les pyromanes qui à toutes les échelles de la vie humaine, ont fait de la guerre et de la haine un nouveau mode de gouvernement. Il tient à nous de réclamer d’être tous des indigènes d’ici, quelle que soit notre origine, et des citoyens de partout, quelles que soient nos pérégrinations. Dans le « Moyen-Âge de la mondialisation » dont parle Paul Virilio[16], il n’y a plus de lendemains qui chantent : c’est ici et maintenant qu’il nous faut à la fois résister et construire, résister pour construire la paix civile, les droits pour tous et la solidarité humaine.
Bienvenus au XXIème siècle.
[1] Le groupe NTM a été condamné en 1997 pour son morceau « Police »
[2] Le Monde 18 novembre à la Une : « La polygamie et le regroupement familial au centre de la polémique. Violences urbaines : les antiracistes accusent la droite d’ « ethniciser » la crise des banlieues »
[3] « Ils ne sont pas malheureux, ils sont musulmans », supplément hebdomadaire de Haaretz daté du 18 novembre
[4] Christian Marazzi, La place des chaussettes le tournant linguistique de l’économie et ses conséquences politiques, édition de l’Eclat, 1997
[5] Henri Lefebvre, La révolution urbaine, Gallimard 1970
[6] Saskia Sassen, La Ville globale. New York, Londres, Tokyo, Descartes, 1996, Olivier Mongin, La condition urbaine, Seuil, 2005, Pierre Veltz, Mondialisation, villes et territoires, l’économie d’archipel, PUF, 1997, Evelyne Perrin, Nicole Rousier, Ville et Emploi, le territoire au cœur des nouvelles formes de travail, L’aube, 2000
[7] lancée par le député Patrick Braouezec au moment des événements de novembre 2005
[8] Christian Marazzi, ibidem
[9] Sophie Body-Gendrot, Nicole Le Guennec, Mission sur les violences urbaines, La documentation française, 1998.
[10] « Nous sommes les indigènes de la République ! » 16 janvier 2005 http://toutesegaux.free.fr/
[11] Alain Bertho, « Malaise dans la République », Mouvements n°38, mars 2005
[12] « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation » affirme dès le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme (article 3).
[13] La conférence européenne des Droits de l’Homme dans la ville a été lancée à Barcelone en 1998. La charte a été signée à Saint-Denis en mai 2000. Une troisième réunion a eu lieu à Venise en décembre 2002. Plus de 200 villes de 21 pays européens avaient signé cette charte à la veille du 4° rendez-vous à Nuremberg en décembre 2004. Référence www.droitshumains.org/Europe/charte_des_DH.htm. Voir aussi Alain Bertho, « Penser la ville monde », Socio-anthropologie n° 15, 1° semestre 2005.
[14] Loi du 23 février 2005 “ portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ”.Article 4 : “ Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. . ”
[15] On lira avec bonheur les pages lumineuses du sociologue polonais Zygmunt Bauman Dans la Société assiégée, Le Rouergue/Chambon, 2005 sur le divorce de la Nation et de l’Etat, et sur bien d’autres choses ainsi que l’ouvrage c de son collègue allemand Ulrich Beck, Pouvoir et contre pouvoir à l’ère de la mondialisation, Aubier, 2003
[16] Paul Virilio , « Le krach de la net-strategie » , L’Humanité du 11 octobre 2001